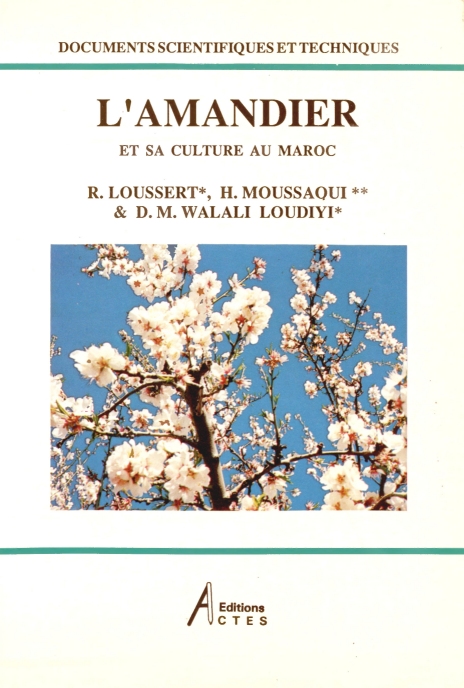L’AMANDIER ET SA CULTURE AU MAROC
R. LOUSSERT*, H. MOUSSAOUI ** & D. M. WALALI LOUDIYI*
• Département d’Horticulture, Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan Il, B.P. 6202 Rabat-Instituts, Maroc
•• Direction des Rosacées de l’Olivier et de l’Apiculture, Société de Développement Agricole, B.P. 763, Rabat-Agdal (Maroc)
Il m’est particulièrement agréable de présenter aux lecteurs la collection «Documents Scientifiques et Techniques», qui, à l’initiative d’enseignants-chercheurs de l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan Il, se propose de diffuser à l’attention des ingénieurs, des techniciens et des étudiants en Sciences Agronomiques, un ensemble de données particulièrement adaptées aux conditions de l’agriculture de notre pays.
Avec «L’ Amandier et sa culture au Maroc», paraît le premier ouvrage de cette collection. Je remercie les auteurs, Messieurs R. Loussert, H. Moussaoui et D.M. Walali Loudiyi pour le choix de cette espèce arboricole qui, malheureusement au Maroc, comme d’ailleurs dans la plupart des autres pays méditerranéens, est à l’image de l’Olivier, victime de sa rusticité. Or, à travers les données présentées dans cet ouvrage, on peut constater quel’ Amandier est l’une de nos espèces fruitières les plus capables de valoriser au mieux les sols de qualités médiocres à condition toutefois que quelques précautions élémentaires soient prises pour l’implantation et l’entretien de cette culture dans les zones bour.
Bien que l’Amandier soit cultivé au Maroc sur une superficie estimée à près de 100 000 ha, notre production d’amandes reste insuffisante, ce qui en fait pratiquement un produit de luxe.
Je me dois de signaler que cet ouvrage ainsi que ceux qui vont suivre dans cette collection sont le fruit d’une collaboration étroite entre des personnes aux compétences complémentaires en pédagogie, recherche, technique et développement Cette collaboration garantit l’adéquation de tels ouvrages aux besoins d’un public qui, jusqu’à présent, ne pouvait que difficilement se procurer les informations pertinentes et à jour, nécessaires soit à leurs études soit à leur vie professionnelle ou à leur perfectionnement Déjà plusieurs ouvrages qui traitent de thèmes divers tels quel ‘Entomologie Forestière, la Défense des Cultures, l’ Apiculture, l’Horticulture, la Malherbologie, l’Hydrobiologie, le Pastoralisme…, sont en cours d’élaboration.
Je remercie tout particulièrement Messieurs A. Fraval et R. Loussert, Professeurs à l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, d’être les initiateurs de cette collection «Documents Scientifiques et Techniques», ainsi que le Professeur M. Ettalibi, Editeur en Chef de la revue Actes de l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan Il, d’avoir accepté de réaliser ces ouvrages et d’en assurer la diffusion. Je remercie également le Service Culturel, Scientifique et Technique de l’Ambassade de France au Maroc d’avoir contribué au démarrage de cette collection.
Dr M’hamed SEDRATI
Directeur de l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II
Avant-propos
Les conditions naturelles du Maroc ont de tout temps permis l’introduction et l’adaptation d’une gamme élargie d’espèces fruitières allant des plus rustiques et des mieux adaptées (l’Olivier, le Figuier et l’ Amandier) aux espèces d’introduction plus récente et nécessitant des soins plus intensifs (le Pommier, le Poirier, le Cerisier … ).
Au début, malgré certaines difficultés de multiplication et l’absence de législation sanitaire, ces introductions ont permis la constitution d’importantes collections dans plusieurs stations expérimentales et diverses régions du pays. Des prospections dans différentes zones du Maroc et des observations en stations ont abouti à des sélections des clones les plus performants de l’olive Picholine marocaine, à la sélection d’hybrides naturels de Dattiers (saïrs), résistants ou tolérants au Bayoud, Fusarium oxysporum (P.) albidinis, ainsi qu’au repérage de clones de Figuier, d’ Abricotier et d’ Amandier plus productifs. Régulièrement mis à jour par des introductions mieux contrôlées, ce patrimoine génétique bénéficie actuellement des nouvelles acquisitions scientifiques et d’une meilleure maitrise des facteurs de production.
Ces dernières années, le patrimoine fruitier marocain s’est enrichi d’espèces et de variétés soit déjà existantes, soit nouvellement cultivées comme le Bananier, le Kiwi, l’ Ananas ou le Nashi. Une meilleure connaissance des aires écologiques de culture, un renouveau au niveau de la profession de pépiniéristes et d’arboriculteurs stimulés par une conjoncture économique favorable et par une politique agricole dynamique, ont fini par façonner le paysage fruitier national en lui assurant une dimension et des perspectives nouvelles. Ainsi, dans la plaine du Gharb, à une altitude d’à peine 100 m, où jusqu’aux années 1970 dominaient des plantations d’ Agrumes, se sont développés des vergers hautement rentables de Pommiers, de Poiriers, de Pêchers, de Nectariniers, de Pacaniers, d’ Avocatiers et de Bananiers sous-serre. De même, la région de Béni-Mellal comme celle d’Agadir connaissent depuis quelques années d’importants développements avec des espèces et des variétés fruitières nouvelles mieux adaptées et ce, sous l’impulsion d’une nouvelle génération d’investisseurs.
Certaines productions fruitières comme les Agrumes ou les Olives de table sont exportées en quantités croissantes non seulement vers les pays de la C.E.E., mais également vers d’autres pays de l’Europe et plus récemment vers les pays d’Amérique du Nord et du Golfe Persique. Ces produits constituent en valeur, un flux de devises important qui contribue à l’équilibre de la balance commerciale nationale.
Les espèces fruitières rustiques comme l’Olivier, l’ Amandier, le Figuier, le Palmier Dattier continuent à jouer un rôle socio-économique important en freinant l’exode rural vers les centres urbains et en contribuant à la satisfaction des besoins alimentaires grandissants du pays. Après l’indépendance, la promulgation du Code des Investissements Agricoles, la formation des cadres dans les divers secteurs de l’agriculture et plus récemment la décision gouvernementale de supprimer l’impôt agricole jusqu’à l’an 2000 ainsi que les encouragements aux investissements privés ont été un puissant moteur pour une véritable révolution verte arboricole.
La création de nouveaux vergers, les reconversions variétales, l’implantation de nouvelles spéculations fruitières dans des zones traditionnellement consacrées aux Agrumes ou à l’Olivier ont contribué à une large diversification des cultures.
En dehors de ces multiples facteurs, ces résultats encourageants sont aussi le fait de:
– la formation continue de l’expérience et la compétence des techniciens de l’ Agriculture;
– l’ouverture du Maroc à la collaboration avec des organismes de recherche et de développement étrangers;
– le dynamisme de certains organismes privés ou étatiques qui ont expérimenté de nouvelles variétés, de nouveaux porte-greffe et des techniques récentes de production (forte densité de plantation, micro-irrigation, maîtrise de la fertilisation par le diagnostic
foliaire, utilisation des régulateurs de croissance pour une meilleure productivité, etc.);
– le contrôle technique et sanitaire de toute introduction nouvelle en provenance de l’étranger pour sauvegarder le patrimoine arboricole des maladies et parasites de quarantaine.
D’autre part, l’accroissement de la productivité ne cesse évidemment de poser de multiples problèmes. Afin d’assurer une meilleure rentabilité de ce secteur fruitier, les efforts techniques déployés, au niveau de la production, devraient s’accompagner de:
-l’organisation des infrastructures agro-industrielles de conservation, de stockage, de conditionnement et de transformation et la création de nouvelles unités;
– l’établissement d’un bilan exhaustif par région de production;
– la création d’un catalogue national fruitier des espèces, variétés et porte-greffe;
-la rationalisation de la protection des vergers par des luttes raisonnées, voire intégrées;
– l’organisation de la profession aux niveaux régional et national;
– la création d’un comité national de l’arboriculture placé sous l’autorité du Ministère de l’ Agriculture et de la Réforme Agraire, qui sera chargé de préserver les acquis, de planifier les actions de recherches et de développement de ce secteur et de promouvoir toutes les actions économiques ou techniques qui contribueront à son épanouissement.