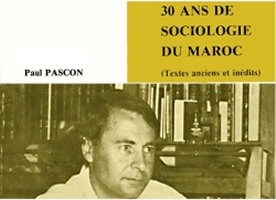30 ans de sociologie au Maroc (1986)
Paul PASCON
Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II

Mythes et croyances au Maroc (1981), Paul PASCON
Les Marocains, comme un grand nombre de peuples, vivent avec plusieurs systèmes de croyances: un ensemble hétéroclite de pratiques rituelles pré-monothéistes, une religion révélée – ici l’Islam – et le respect de la science moderne. L’hétérogénéité manifeste de ces ensembles gnosiques pour tout observateur extérieur, ou pour tous ceux qui s’enfermeraient dans un seul de ces trois sous-systèmes, ne pose guère de problèmes aux usagers. Les Marocains seraient – pour la plupart évidemment[1] – très étonnés d’entendre qu’il puisse Y avoir incompatibilité, voire contradiction ou exclusion, entre ces différents univers conceptuels ou idéologiques. Pour la plus grande masse des gens au contraire, la porte de la Connaissance et de l’Action peut être symbolisée par un arc dont le seuil repose sur le monde directement sensible, la colonne de gauche figurant le corps des connaissances empiriques, celle de droite le corpus des connaissances expérimentales, les cintres représentant l’approfondissement ésotérique à gauche et exotérique à droite, le tout étant couronné et tenu par la clef de voûte de l’Islam, alpha et oméga de tout logos. Mais qu’un seul de ces éléments manque, et le tout s’effondre ou revient à des bribes et morceaux ruinés sans signification générale, donc sans efficace.
La religion révélée, légitime et légale, étant la pierre de touche finale, l’explication et le cadre de toute croyance apparemment hétérodoxe ou de toute innovation moderniste, il reste cependant à rappeler le fond le plus obscur, le plus mystérieux et le plus énigmatique qui cohabite avec le Livre et la science moderne dans la crédulité populaire.
Il s’en faut de beaucoup pourtant que ces croyances plurielles s’excluent les unes les autres. Bien au contraire, sans cesse revivifiées dans le commerce d’un système avec l’autre, les mythes et les croyances s’usent, renaissent, se transforment, en empruntant à chaque univers sa forme de rationalité, de merveilleux, de sensibilité et son type de preuves.
Syncrétisme donc, ou respect de registres parallèles co-existants, cohabitant dans l’alliance comme dans la compétition, le système des mythes et croyances au Maroc n’est évidemment pas le même pour le mystique soufi, le clerc citadin, le paysan illettré, l’étudiant en faculté des Sciences et l’ouvrier spécialisé. Chaque type de crédulité dénie à l’autre valeur pratique même si, au fond, c’est toujours le plus religieux qui l’emporte … publiquement.
Syncrétisme, pluralité, mais encore évolution: on ne peut plus décrire les rapports de la magie et de la religion au Maroc de 1981 comme le faisaient au début de ce siècle les grands ancêtres de l’anthropologie des croyances: Westermarck, Doutté et Dermenghen[2]. Le Maroc a connu deux grandes révolutions – si l’on donne à révolution le sens de profonde transformation socio-culturelle – l’islamisation, commencée il y a un peu plus de treize siècles, et l’industrialisation au début du XXème siècle. Ces deux mouvements n’ont pas encore cessé de progresser et de bouleverser de fond en comble l’ensemble des pratiques et des croyances. Toutes étude sérieuse ne peut retenir le moment présent comme immuable, et ce serait trahir la bonne foi du lecteur que de laisser croire à l’irrésistible et continue domination d’un système plus récent sur un autre. Bien au contraire, des résurgences inopinées surviennent, des résistances inattendues se font connaître, des hybridations imprévues s’observent, des emprunts soudains sont pratiqués à des sources lointaines et jusqu’ici inconnues (Pakistan).
Tout ceci pour prévenir le lecteur qu’il ne se trouve pas ici devant une matière simple, un discours définitif, une description arrêtée.
Si, chemin faisant, l’auteur laisse échapper quelques phrases lapidaires, prend des raccourcis réducteurs ou pose des schémas simplistes, c’est plus par incapacité rhétorique à restituer la profusion du réel et l’enchevêtrement des faits que par désir de transmettre un système tout fait, organisant la matière dans un ensemble clos.
1- MYTHES ET CROYANCES PRÉ-ISLAMIQUES
Les forces de la nature et de la société humaines n’ont pas attendu les religions révélées pour être stigmatisées dans des représentations générales afin de servir de code de conduite et alimenter la formation des idées morales et des comportements efficaces. Lorsque l’homme était si faible, devant la Nature et devant ses semblables, qu’il n’avait trouvé encore l’échappée vers une idéologie du salut, il fallait bien qu’il fasse entrer les forces naturelles elles-mêmes dans l’alchimie de ses mythes.
Et c’est d’abord dans ses formes telluriques que l’habitant de cette planète déchiffre les signes et les soupirs de la terre. Au Maroc, le culte des grottes et des sources est un phénomène majeur[3]. Une opinion rationaliste a trop vite justifié l’importance des mythes cavernicoles en rappelant le troglodytisme des Berbères et le culte des sources par l’évidente importance de l’eau en pays aride. Sans doute ces arguments ne sont-ils pas à écarter, mais ils n’expliquent point, bien au contraire, les craintes superstitieuses qui sont attachées à ces lieux. Les héritiers de populations troglodytiques, donc de familiers des grottes, y situeraient-ils tant de miracles et d’effets mystérieux ?
Il semble plutôt que les grottes et les sources sont les orifices de sortie et d’expression des profondeurs de la terre et des génies souterrains. Les cavernes sont la bouche, le ventre des forces telluriques, les sources sont des yeux en arabe comme en berbère (0 ayn, tît) d’où coulent des pleurs. Et dans ces profondeurs, habitent les génies (jnûn), qui s’en évadent à certaines heures ou certaines nuits, ou qui veillent sur les trésors qui y sont enfouis. Il est remarquable que la légende de Jouder le pêcheur (conte des Mille et une nuits) situe au Maroc l’épisode de la grotte où sont entassés tant d’or et de pierreries. Dans les cavernes, où se sont formées stalactites et stalagmites, des cultes particuliers sont pratiqués selon qu’on prend ces formations pour des bougies (innombrables sanctifications de Bouqnadel)[4], pour des pis de vaches, dont les suintements sont donnés pour du lait mystique (grotte de Moulay Bou Selham), ou encore pour des cortèges de génies ou d’animaux fantastiques pétrifiés (grotte de Taghardacht dans les Branés de Taza).
Les grottes, c’est bien connu, parlent. Les esprits profonds exhalent, l’air qui y circule fait entendre des gémissements, des cris, des sifflements; les sources intermittentes bouillonnent et mugissent. Les pèlerins viennent y écouter des oracles, réponses, à leur désarroi, comme à Demnate (Sidi Bou Inder). Près d’Igherm de l’Anti-Atlas, des femmes lapident l’entrée d’une grotte refermée sur un fiancé parjure, puis écoutent ses cris et interprètent ses oracles.
Faut-il prolonger la tradition oraculaire des grottes pour comprendre l’ancienne pratique de l’incubation (istikhar)? A la veille de prendre de graves décisions, il est recommandé de faire le vide en soi, de se purifier, de se concentrer et d’examiner la valeur des choses et ses intentions profondes. L’incubation et le sommeil, dans certains grottes célèbres (Tagandout des Niknafa, Taghia Ikhnifen du Sous, Sidi Chamharouch au pied du jbel Toubkal…), permettent de recevoir des présages et des songes qu’il ne reste plus qu’à interpréter – des foqaha sont là pour cela – afin de connaître la Voie droite et la Conduite propice.
Les grottes, encore, sont les lieux privilégiés de l’expulsion du Mal et leurs vertus thérapeutiques sont connues à grande distance. On y séjourne pour résoudre toutes sortes de difficultés mentales ou physiques. Comme les maladies sont censées être de fait des génies, quoi de plus naturel que d’aller chercher d’autres génies dans les lieux mêmes de leur résidence pour expulser les premiers ? Aussi les principales affections soignées sont-elles celles de l’esprit, ou qui passent pour telles: épilepsie, schizophrénie, folie en général, c’est-à-dire maladies dont on dit des sujets qu’ils sont «possédés». Mais on y rend visite également pour les troubles de la fécondité: stérilité, avortements répétés, défaut d’enfant mâle. C’est l’endroit pour évoquer des rites maintenant (totalement ?) disparus, dans certaines grottes célèbres (Zkara de Taza, Ilalen de l’Anti Atlas …), ceux de «la nuit de l’erreur» (laylt al-R’alat): des contribules des deux sexes entrent dans la grotte pour célébrer Je solstice d’hiver, ou l’équinoxe de printemps, et s’adonnent à des relations sexuelles libres.
Les lieux humides et spécialement les sources, surtout si elles sont thermales, et encore davantage si elles sont sulfureuses et produisent des vapeurs, sont les sites réputés où se tiennent les génies. Presque toutes les sources ont une histoire légendaire dont la plus courante est celle inspirée de Moïse frappant la terre de son bâton pour en faire jaillir l’eau. Une tradition vivace prétend qu’il s’agit d’actes techniques, au temps où la Terre était gorgée d’eau et qu’il suffisait de percer la carapace pour faire surgir des eaux artésiennes. Mais cette explication matérialiste ne suffit pas; les saints et les génies sont nécessaires, et souvent suffisants, pour faire sourdre des écoulements bienfaisants; et la désaffection de leurs cultes ou la méchanceté des hommes sont la cause des étiages et des assèchements. Hormis les grottes, c’est près des sources, des marais et des lacs, que la densité des génies est la plus grande; on ne s’en approche pas sans précaution, sans respecter leur désir de silence et de discrétion et l’on écarte leur éventuelle malfaisance par l’invocation de puissances supérieures à eux. Découvertes par les génies ou les saints, les eaux ont évidemment des vertus thérapeutiques: elles guérissent des maladies (les fièvres notamment) et la stérilité causée par les jnouns.
C’est dans les lieux humides qu’habite la jenniya majeure Aycha Quandicha, l’un des rares génies au Maroc affublé d’un nom propre et d’une personnalité définie, quoique ambivalente. Pour certains, c’est une jeune femme ardente qui séduit, ensorcelle et dévore ses amants comme la Vouivre champenoise ou la Morgane bretonne; pour d’autres, c’est une vieille sorcière envieuse qui prend plaisir à défaire les couples. Il semble que cette Aycha soit l’antique déesse de l’Amour Astarté, qui était adorée dans tout le bassin méditerranéen par les Chananéens, les Phéniciens et les Carthaginois et alimentait les cultes de la prostitution sacrée. Si aujourd’hui Aycha Qandicha ne fait plus peur qu’aux jeunes enfants, il s’en faut de beaucoup qu’elle laisse indifférents les adultes, même scolarisés; son évocation dans un amphithéâtre de faculté déchaîne des rires nerveux, pas toujours ironiques, et un professeur de philosophie européen, ayant entrepris d’écrire un mémoire sur son compte, décida de brûler tous ces documents et d’interrompre ses recherches à la suite de trop nombreux et inexplicables accidents.
Les trésors souterrains[5]
À écouter les habitants de ce pays, on pourrait croire que le Maroc est un dépôt fantastique de trésors. Dans chaque région, des personnes sages et pondérées vous assurent avoir les preuves certaines que de fabuleux magots en pièces d’or, pierreries, armes de prix, ont été récemment découverts ou sont en passe de l’être. On peut se rendre avec elles sur les lieux (cimetières, tas de pierres votives, ruines de villages en forêts ou sur le sommet de hautes collines) et l’on vous montre des excavations, des déblais ou des trous naturels où sont censés avoir opéré les découvreurs. Le protocole de ces découvertes est sensiblement toujours le même: deux tolba du Sous[6] arrivent un soir dans un village et demandent l’hospitalité. Ils ont des allures cérémonieuses, des préoccupations intérieures, comme s’ils étaient habités d’une mission divine et secrète ; silencieux, ils s’adonnent strictement aux obligations religieuses (ablutions, prières) et ont des pratiques surérogatoires (psalmodies, chapelet…). Puis ils s’entretiennent dans leur langue – le berbère est loin d’être parlé partout- en de longs conciliabules à voix basse. Au milieu de la nuit, ils demandent à sortir de la maison et s’en vont avec des sacs et des outils dissimulés. Si l’on entreprend de les suivre – ce qui demande du courage et une solide protection contre les génies – on les voit user d’un grimoire pour retrouver des lieux précis qu’ils repèrent en comptant leurs pas. Ils passent la nuit à creuser et au petit matin l’espionneur s’est endormi comme par miracle et ne retrouve plus personne, ni la moindre trace, sauf une excavation faite de fraîche date.
De ces comportements, les Marocains ont des explications rationnelles. Il est toujours question de trésors enfouis soit par des peuples anciens (Romains, Portugais, Espagnols, chrétiens en général), soit par de puissants personnages du passé ayant dû quitter précipitamment le pays sans pouvoir emporter leurs richesses. Le récit le plus courant est celui du pèlerin parti pour accomplir à la Mecque son devoir de musulman, ayant laissé un viatique à sa famille et caché sa fortune en un lieu connu de lui seul pour le retrouver à son retour. Dans les temps anciens, le voyage pouvait durer des années et bien des aventures survenir. Pour ne pas oublier la cache de son trésor, le pèlerin consignait les lieux sur un bout de parchemin. La mort, ou d’autres vicissitudes, feraient tomber ces documents entre les mains de réseaux soussis très organisés qui tissent leurs mailles jusqu’en Arabie et s’accaparent les restes des pèlerins marocains. Les chercheurs de trésors ne seraient en somme qu’un des rouages d’une gigantesque organisation occulte confinant à la magie et familière des génies puisque tout cela se passe la nuit et intéresse la profondeur de la terre.
Les talismans (h’irz, hûruz)
Peu de gens au Maroc vivent sans la protection de talismans. Partout dans le peuple, on voit de jeunes enfants, les femmes enceintes, les malades, les personnes difformes ou handicapées, porter autour du cou de minuscules sachets, contenant quelques grimoires prophylactiques. Les automobilistes suspendent des chapelets ou des signes votifs au rétroviseur intérieur de leur voiture, et les camionneurs prennent bien soin de protéger leur engin, devant et derrière, par quelques formules religieuses et la main dite de Fatima. Les animaux mêmes (poulains, chamelons) portent des talismans. Partout où le danger est bien réel et de probabilité élevée, les Marocains associent aux précautions matérielles, l’assurance financière, la prophylaxie religieuse et la protection magique.
Car si le malheur est causé par des pratiques maladroites, des défauts de jugement et des procédés inadéquats, on sous-entend aussi qu’il n’est pas le fait du hasard mais de l’action de forces occultes, ennemies et sataniques, qu’il faut conjurer par des procédés du même ordre. Ce sont les tolba encore qui s’entremettent pour la production de talismans efficaces. Il suffit d’aller sur les places publiques, en marge des marchés permanents ou hebdomadaires, pour trouver des scribes capables de dresser des grimoires, des carrés magiques (idoual), mêlant des formules religieuses à des scolies ésotériques contre quelques dirhams. Devant ces talismans, les forces du Mal sont sans effet; elles sont frappées d’épouvante et reculent impuissantes: c’est le Retro Satanas du monde chrétien. Ce n’est pas le lieu de rechercher les sources historiques des talismans, il suffit de signaler qu’ici encore l’Islam – ou plutôt les entrepreneurs indépendants de la gestion de l’Islam – ont récupéré à leur profit et avec la faible dépense de quelques pieuses paroles et benoîtes pratiques, le capital symbolique de l’écriture incantatoire, des chiffres et de l’arithmétique magiques. La même fascination, qu’exercent sur les mathématiques les plus modernes les nombres premiers et leur combinatoire, n’a cessé de captiver l’humanité et de la tenir sous son charme. Ainsi des nombres 1, 2, 3, 5 et 7 et de leurs arrangements. Mais ces nombres, en outre, peuvent s’écrire sous forme de lettres. Avant le développement de l’arithmétique, les lettres de l’alphabet avaient des valeurs numérales[7] et les idéogrammes littéraux pouvaient grouper des lettres ayant ainsi une double signification: combinatoire arithmétique et mots significatifs (illustration). L’art du talisman vise justement à obtenir le maximum de signifié magico-religieux, avec la plus grande économie de signes; de même, l’un des arts de la poésie est de faire interférer les plus riches signifiants, avec un arrangement euphonique de sons et de rythmes.
Ce sont généralement les tolba, les foqqaha, c’est-à-dire les clercs, qui rédigent ou plutôt dessinent les talismans. Cette qualité de connaisseurs, de la langue et de la religion les met immédiatement à l’abri de toute suspicion paganiste. Quoique les savants docteurs de la Loi musulmane et les authentiques croyants rejettent comme hérétiques les pratiques obliques de faiseurs de talismans, le menu peuple, qui constitue la grande masse de leurs clients, ne retient pas ces subtilités. Dès l’instant où les formules rituelles de la profession de foi ou de l’introït couvrent les grimoires, les gens peu instruits ne peuvent croire que les lettres arabes et l’écriture du Livre sacré puissent être impies.
Le corps de ces clercs obscurs, disséminés dans les campagnes, joue un rôle principal dans l’entretien des croyances à la magie et dans la perpétuation du mysticisme populaire. Souvent fils de famille déchues ou cadets de familles puissantes écartés du pouvoir ou de l’héritage de fait par quelques frères plus habiles, les tolba ou petits foqqaha de campagne sont censés avoir été frustrés, dépossédés et avoir détourné leurs désirs de domination vers des procédés plus souterrains.
Si, comme tous les hommes, les Marocains sont sensibles à l’injustice, ils ont plus que d’autres peuples le sentiment que la victime d’une situation apparente investira les voies les plus obscures pour se venger, ou seulement pour acquérir une puissance magique. D’où la crainte de l’envie et de l’envieux. Hors de la relation commerciale, si vous désirez excessivement une chose au point de la regarder fixement ou de la déclarer belle ou enviable, le possesseur de cette chose s’empressera de vous l’offrir, plutôt que d’avoir à endurer les Pratiques détournées que malgré vous vous engagez contre lui pour l’obtenir.
Par excellence, le «mauvais œil», c’est en somme l’œil envieux. Si vous visitez une famille marocaine et que vous y voyez un bel enfant, dites aussitôt: Tbark Allah alih! que la bénédiction de Dieu soit sur lui, afin de bien affirmer que votre louange, ou votre compliment, est indemne de toute envie.
C’est pourquoi toute chose désirable ou exposée porte une main, le membre qui, par excellence, peut protéger de l’œil. Contre l’œil jeté (la jettature) la paume, les cinq doigts dressés, est le recours magique le plus sûr: khamsa fi aynik !«cinq dans ton œil !»
La malédiction et la baraka
Un grand nombre de Marocains pensent que dans toute assemblée, groupe d’hommes étendu, il existe des personnes qui peuvent s’affranchir des contraintes matérielles qui pèsent sur les conditions d’existence des autres hommes. Si l’ubiquité et l’invisibilité sont des vertus qui semblent aujourd’hui disparues – on ne les rencontre plus que dans des récits du passé – par contre, la transmission et la lecture directe des pensées, l’hypnotisme, le maniement de la malédiction et de la grâce, c’est-à-dire la communication directe agréée par les puissances célestes et spécialement par Allâh, sont considérés comme pratiques courantes aux mains de rares personnes.
Ces pouvoirs occultes, ces bénéfices magiques, sont au profit – ou pour le malheur – de certains individus malgré eux et souvent à leur insu. On découvre parfois soi-même avoir un charme après une série de coïncidences surprenantes, après telles paroles, tels rêves … D’autres sont désespérés d’être ainsi marqués par le destin. Dans une grande famille marocaine, un sous-lignage évincé de la succession politique porte le pouvoir de soigner par talismans certaines maladies mortelles; mais lorsque ces soins viennent à être appliqués au profit d’un parent proche, le guérisseur ne survit pas; pourtant il ne peut s’abstenir de soigner. Très souvent ces hommes de baraka, de grâce, pouvant attirer le bonheur ou le malheur sur leurs relations, sont reconnus être des marginaux: pauvres, modestes, parfois même mendiants, ils sont diminués par des difformités ou des handicaps physiques; ou bien ils sont chétifs, infiniment modestes, silencieux, absorbés par une vie toute intérieure. Si l’on n’est jamais sûr que tel homme porte un charme, on soupçonnera toujours quelqu’un d’extraordinaire d’être habité de forces obscures et déchaînées. Prudence d’une société qui se méfie des envieux, des déshérités et de tous ceux qui pourraient se venger de leur effacement du monde visible par leurs pouvoirs sur les forces invisibles. Sagesse aussi qui tend à compenser l’injustice sociale en créant un champ d’incertitude: la croyance dans le pouvoir occulte des pauvres et déshérités s’alimente des scrupules des dominants. On ne croit pas à la lutte sociale, force coalisée des parias, mais à la malédiction de ceux-ci et au déferlement de malheurs qu’ils peuvent appeler sur les nantis. Le sakht (malédiction) et 1’âr (transfert de l’injure) sont une autre manière de redistribuer le malheur. Jeter 1′âr, c’est rendre l’autre maintenant victime de ce dont je suis victime ou dont je serai plus tard. Vos in mea injuria despecti estis «Dans mon outrage, vous êtes outragés» (Salluste, Guerre de Jugurtha).
Précautions temporelles
Le monde n’est pas qu’une structure matérielle visible faite de contraintes et de possiblités; il est aussi une structure immatérielle faite de temps, de rythmes et de signes cachés. Les sociétés matérialistes artificialisent leur environnement et tentent de faire disparaître toute contrainte, pour édifier des espaces stables, indéfiniment prévisibles et dominables. Les sociétés qui sont à l’aube des précédentes donnent plus d’importance à la gestion du temps et à la volonté intérieure des acteurs.
Au Maroc, les ruraux vivent avec quatre calendriers simultanément: zodiacal, julien, musulman et grégorien. Et l’on doit s’interroger sur le maintien de cette profusion de références au temps. Alors que le calendrier astral, en Europe, relève des seules croyances magiques, au Maroc, il découpe exactement en décades le calendrier des pratiques agricoles.
Il s’en suit seulement que la circulation astrale rythme la vie matérielle et la vie spirituelle à la fois, grâce au calendrier d’Ibnal Banna[8] répandu dans toute la campagne et dont chaque fqih de village sait quelques bribes.
Mais les foqqaha ne font pas que répandre et perpétuer le comput astral, ils règlent pour tous leurs clients le rythme hebdomadaire. Les jours, divisés en cinq périodes par les cinq prières, ont valeur magique, bénéfique ou maléfique, de même que chacune des périodes de chaque jour. Mais ceci n’est pas également valable pour tous. Selon certaines conditions précises, établies mystérieusement pour chacun d’entre nous, le lundi matin doit être évité pour entreprendre un voyage, on se refusera à traiter une affaire importante tel mardi après-midi, on tiendra pour risquer de commencer le mercredi etc… Ce calendrier secret de chacun rythme la vie personnelle et explique souvent certains retards, certains refus, certaines excitations. Bien entendu, la vie moderne fait disparaître peu à peu ces précautions calendaires, mais au détour d’une confidence on peut découvrir, soudain, que telle désinvolture ou refus de rencontre ne sont pas dus à la paresse ou au désintérêt, mais au respect d’un rythme intérieur. Dans d’autres circonstances, d’ailleurs, la subjectivisation du temps permet de jouer la comédie ou d’éviter une corvée, telle la migraine ou la maladie diplomatique dans les sociétés européennes. Mais de même que la maladie objective est souvent une réponse sournoise à la contrariété, les comportements inadéquats, et les gestes manqués sont souvent donnés au Maroc pour être le résultat d’un irrespect de l’horloge intérieure personnelle qui ouvre la porte à Satan.
Au contraire du chrétien habitué à battre sa coulpe, le Marocain d’une manière générale ne se tient pas responsable d’une conduite défectueuse, voire d’un mensonge. Censé être pur d’intention malfaisante ou de comportement maladroit, il ne peut être pris en défaut qu’à cause de l’Autre ou parce qu’il a été troublé par le Malin. À quelqu’un qui ment on dit: Allâh in al saytan ! «Dieu maudisse Satan !» Car c’est lui qui s’est introduit dans un moment sinistre et a parlé à la place de soi.
L’Islam au Maroc
Les Marocains sont de musulmans convaincus. La profession de foi commence par l’affirmation de l’unicité de Dieu et l’absence d’autre déité que celle d’Allâh (La ilah Ilia Allâh). Toute chose doit être commencée au nom d’Allâh (bi ismî Allâh) et la louange et l’adoration ne peuvent s’adresser à d’autres qu’à Allâh (al h’amdu li Lhâhi wa h’dahu).
Mais le Dieu des musulmans est trop abstrait pour la ferveur populaire. Les petites gens ont besoin de relais plus proches, d’intermédiaires, d’intercesseurs qui parlent un langage moins ésotérique.
L’absence d’un clergé régulier, chargé du souci quotidien des âmes inquiètes n’a pas empêché le développement de pratiques obliques au bord de l’hérétisme – corporification, sanctification, confrérisme – ni les excès ascétiques et les poussées sectaires. Si Dieu est unique, la manière de le servir est plurielle, et toute l’histoire religieuse du Maroc est l’histoire de la réduction des pulsions d’un paganisme sans cesse en résurgence. Entre la magie, l’Islam populaire, l’Islam orthodoxe et l’Islam mystique, il n’y a pas toujours exclusive; il y a souvent co-existence, voire alliance et relais. Les saints justement sont ceux-là qui, mystiques, ont fait triompher l’Islam combattant et rigoureux dans les espaces païens et magiques et qui ont été ensuite peu à peu vulgarisés et récupérés dans une inévitable confusion d’hérésies et d’orthodoxie. Itinéraire et pente fatale perpétuellement repris, les périodes de désarroi étant propices à la reconstruction d’un système toujours menacé par son entropie interne.
Le culte des Saints
De tous les pays musulmans, le Maroc passe pour honorer le plus grand nombre de saints. Il n’y a guère de collines qui ne soient couronnées d’un sanctuaire, peu de villages ou de cimetières sans mausolée glorifiant un saint, ou plusieurs. «Le Maroc pays des cent mille saints !» ne serait pas un slogan excessif.
Mais ce grand concours de saints a sa géographie, son histoire, ses hiérarchies avec des maisons-mères sous la forme de puissantes et opulentes zaouïa-s, des succursales où officient des sacristains, des offertoires et des stations souvent désertes et hors des routes mais où se presse, tel jour calendaire, un peuple de pèlerins.
Les vertus de ces saints peuvent être fantastiques, tel Sidi Rahhâl qui planait dans les airs autour de la Koutoubia de Marrakech et chevaucha le lion dans la cage duquel un terrible souverain l’avait mis en cage. Ou bien un excès d’ascèse a frappé ses contemporains, tel Sidi Briyim qui vivait d’une datte par jour. Le fondateur de la zaouïa de Tasaft dans le Haut-Atlas passait pour ubiquiste. Sidi Ahmed ou Moussa, le grand saint du Sud-Ouest, a fondé son crédit symbolique autant sur sa vraie foi que sur le récit d’un nombre incalculable de miracles. Ne dit-on pas qu’à la cour de Baghdad, ayant été mis au défi par de savants docteurs de prouver sa puissance spirituelle, il frappa du pied et un arganier – arbre oléicole endémique du Sud-Ouest du Maroc – vint se planter au milieu de ses contradicteurs ? On montre encore aujourd’hui, dans le Sous, l’excavation créée à l’endroit où l’arbre s’arracha. Jurer du nom de Sidi Ahmed Ou Moussa est un acte redoutable. Il y a un peu plus d’un siècle, un homme ayant promis sa fille en mariage à un autre lignage se ravisa le jour des noces. Le père du fiancé menaça le parjure des foudres du saint: «Par Sidi Ahmed ou Moussa, les filles de ta descendance ne pourront plus être mariées normalement». Et depuis ce temps, les filles de ce lignage, lorsqu’elles deviennent nubiles, disparaissent quelques jours ou quelques mois et reviennent par enchantement ne se souvenant de rien, parfois indemnes, parfois pas, mais toujours suspectées. De récentes enquêtes de gendarmerie ne sont pas parvenues à éclaircir le mystère.
On voit bien comment l’intercession des Saints permet la formation et la perpétuation des idées morales. C’est souvent pour consolider les normes de la vie sociale qu’est interpellé le saint. Aussi le marabout est-il un enjeu manipulé par les forces en place. Supposé être au-dessus de la mêlée, il est en réalité entre les mains d’une gestion triviale de ses charmes et de son capital symbolique au profit du système social. D’où la profusion des saints. Les grands sanctuaires resplendissants étant au service des dominants, les petites gens sont bien contraintes de s’adresser à des personnages plus obscurs et plus frustes.
Mais les saints sont aussi des hommes de Dieu; on dit qu’ils sont des proches (walï) de Dieu. À l’examen, ils ne sont pas censés agir eux-mêmes, mais intercéder auprès d’Allâh, «Il n’est de force qu’en Lui ! Et sur toute chose il est patent !» Aussi les sanctuaires majeurs sont des espaces de piété, d’approfondissent de la foi, de la religion et de la lecture du Livre. Pour que le toit du marabout puisse aller jusqu’au Ciel, il faut que l’orthodoxie de son établissement soit indiscutable. C’est pourquoi l’ensemble des pratiques, les plus régulières et les plus discutables peuvent se tenir au même endroit, les premières couvrant les autres.
Par exemple, l’idolâtrie est bien le culte le plus réprouvé par l’Islam, celui qu’il a dû poursuivre le plus violemment dès les premières années de son avènement. Les idoles (açnâm) ont été systématiquement détruites, brisées ou brûlées. Pourtant, les pierres au Maroc transportent toujours des vœux et sont des objets directs de dévotions détournées. On surprendrait bien un Marocain du peuple en lui faisant remarquer, comme le font les Islamistes, qu’il est en partie idolâtre, puisqu’il confie ses vœux à des pierres, à des bandes de chiffons, à des arbres … Il vous répondra toujours que c’est la tombe d’un saint et que ce saint était un musulman convaincu et un défenseur de la foi (moujahid), qu’il est un intercesseur (wali) et que c’est sa mémoire qu’on honore et non la pierre que l’on dépose.
Si l’Islam est une des religions qui est allée le plus loin dans la liquidation des supports matériels de la foi, il n’y est pas parvenu encore totalement au Maroc. C’est peut-être parce que la dévotion abstraite est au-dessus des forces et de la formation présente des fidèles et que le transfert matériel aide encore à porter le culte. Si quelques personnes frustes et ignorantes finissent par prendre les moyens pour la fin, c’est au plus instruit, au plus orthodoxe que revient le devoir de les remettre sur le droit chemin.
Le réseau des sanctuaires qui tisse les mailles les plus fines du filet magico-religieux tendu sur le pays est encore traversé par la forte armature des confréries (derqawa, tijania, cherqawa, etc…) sortes de chaînes mystico religieuses, mais clubs politiques confidentiels aussi.
Enfin, les pôles des centres mystiques du soufisme surplombent le tout. Les mouvements islamistes (Frères musulmans, Boutchichiyine etc…) bousculent actuellement cette routinière construction formaliste. Mais est-ce vraiment nouveau? Qu’ont donc été, en leur temps, les héros de l’Islam maghrébin exigeants et ascétiques, tels Jazouli, Tijani, Abdeslam b. Mchich …? L’Islam contestataire d’aujourd’hui n’est plus peut-être que la résurgence toujours renouvelée du combat de l’ésotérisme contre l’exotérisme, en d’autres termes des fondements abstraits de la foi contre la gestion triviale des apparences (État, gouvernement, société civile …). Cette montée présente de l’islamisme est une période chaude occurrente dans le cycle de l’histoire froide de l’Islam.
La connaissance de l’Islam au Maroc n’est pas simple. Elle peut commencer par la connaissance partielle et séparée des pratiques et croyances réellement observées, se poursuivre par l’examen du passage des unes aux autres, des conflits, et oppositions créées entre elles en même temps que les alliances de fait qui les font s’épauler tout en se condamnant ou en s’ignorant. Les hérésies qui prolifèrent autour d’un sanctuaire sont tolérées de fait par ceux-là mêmes qui les fustigent: un orthodoxe sait bien qu’il ne peut drainer vers lui qu’un faible pourcentage de croyants véritables; les pratiques «douteuses» lui constituent un vivier dans lequel il puise et sélectionne ses ouailles. Les uns sont aux autres nécessaires. Sans paganisme à dénoncer, comment s’indigner et proclamer la Vraie Voie ? Et sans l’alibi de celle-ci, comment tenir des séances à la limite hérétiques ?
Plus profonde est la question de l’importance de l’Islam dans la conscience des Marocains (et de beaucoup d’autres peuples musulmans sans doute). La pensée occidentale de l’âge industriel s’étonne de la place prise par la religion au Sud et à l’Est de la Méditerranée et, derrière Auguste Comte, ne parvient à se satisfaire qu’en évoquant l’existence d’âges magique, religieux, social, économique … se succédant les uns aux autres dans une perspective unilinéaire. Ne les surprend, en définitive, que l’extraordinaire reprise de l’Islam en contemporanéité avec le progrès scientifique et technique. Mais la force de l’Islam est peut-être ailleurs, dans la capacité exceptionnelle à accepter le tragique, la soumission de l’homme au fatum dans ce bas-monde, en offrant une issue uniquement spirituelle à l’obscur de la destinée humaine. L’effondrement des utopies modernes de progrès face à la montée démographique et l’incapacité des pays dominants à raisonner le long terme donnent un nouveau souffle au retour à la foi traditionnelle.
Aussi une vision plus matérialiste appelle d’autres arguments : les conditions moins favorables au progrès technique au cours des trois derniers siècles, le choc de la domination coloniale et le repli sur une identité religieuse seul refuge sécurisant, la non séparation de la religion et de l’État… Si ces facteurs ne peuvent manquer de jouer, il s’en faut de beaucoup qu’ils suffisent. Ce serait renoncer au moindre degré d’autonomie du mouvement spirituel lui-même. L’Islam fait de l’obéissance à Dieu, au chef et au Père une religion, et de toute protestation ou innovation, hors de la doxa déclarée, une hérésie. La malédiction frappe toute entreprise en rupture avec la tradition. Et si une tentative réussit, son succès est jugé provisoire, le temps d’une épreuve qui ne manquera pas de marquer sa défaite. La cause de l’échec réside non dans le manque d’effort des hommes, de leur vertu ou d’une poursuite en avant de l’innovation, mais plutôt dans la prétention même à l’originalité, à la différence d’avec la pratique commune. De sorte que la seule révolution légitime est celle qui d’abord déclare ramener, remonter aux sources. La source par excellence est le Coran. La Tradition (sunna), les Récits (hadit), les commentaires, sont des sources mineures, des excroissances concentriques, jugées plus ou moins éloignées, plus ou moins légitimes selon les siècles et les sectes, comme des interprétations inégalement garanties par la transmission des croyants.
La question cruciale concerne l’appréciation de deux mythologies simultanées: l’unanimisme du groupe en matière religieuse, et l’émergence de la sainteté. Deux conceptions en apparence tout à fait antagonistes: tout le monde doit faire ce que la tradition ordonne unanimement et sans distinction, et en même temps surgit le saint qui seul pratique autrement, ressource le comportement, remet la tradition sur la Vraie Voie.
Contradiction superficielle en réalité. Le mythe du groupe homogène, pur, proclamant son unicité, adhérant ensemble à une même règle est de ceux qui habitent ce peuple. La marginalité n’est pas intolérable si elle est exceptionnelle, rarissime, unique. Elle est condamnable et mal tolérée si elle constitue une secte, un sectionnement du corps social. Dans le comportement traditionnel, aucun commencement, aucun initium même le plus modique – comme débuter les labours ou gauler les olives – ne peut être le fait d’un homme courant. Seul un personnage hors du commun, doué d’un charme, d’un lignage reconnu chanceux, ou atteint d’un handicap physique ou mental, peut être chargé par le groupe de commencer une opération que tout le monde alors pourra effectuer derrière lui. Seul l’éminent, le chérif en somme, peut initier dans tous les sens du terme. L’étymologie même du mot est ambivalente. À l’origine, le chérif c’est exactement l’Éminence, c’est-à-dire celui qui dépasse les autres, notabilité singulière par quoi on reconnaît sa suprématie de fait sur le groupe, c’est donc le chef, la tête. Mais on sait qu’au Maroc – et dans d’autres pays musulmans – le chérif est celui qui descend par filiation agnatique directe, donc par voie masculine, de la fille du Prophète.
D’où le chérifisme, caractère spécifique de la vie mystico-religieuse et politique du Maroc. L’extension historique du chérifisme au Maroc pose question. Depuis l’arrivée des Arabes et de l’Islam, le Maroc a connu successivement six dynasties de souverains: la première (ldrissite) et les dernières (Saâdite et Alaouite) sont dites chérifiennes, en ce sens qu’elles procèdent de la dévolution généalogique du Prophète. Les choses ne s’arrêtent pas là. Tous les saints, à très peu près, revendiquent la descendance prestigieuse, mais les grands chefs aussi ! La question qui se pose est de savoir pourquoi la descendance masculine du Prophète prédestine à la sainteté et à la chefferie à certains moments de l’histoire, au point que le saint ou le chef, qui jusqu’avant d’atteindre un certain degré d’autorité ne proclamait guère son appartenance au noble lignage, fait des efforts, une fois reconnu, pour prouver son chérifisme ? Tous les saints et les chefs ne sont pas chérifs mais les plus grands ne peuvent manquer de l’être. C’est reconnaître d’une part l’idéologie et la mythologie patriarcale de la transmission des vertus par le sang, et seulement par la voie masculine (sauf le premier maillon, le prophète n’ayant pas eu de descendance mâle), et d’autre part il n’y a pas de plus grande vertu que celle du Prophète, choisi prec1sement pour cela par Dieu pour être Son envoyé sur la terre.
Pour refuser l’existence d’un clergé régulier, les croyants n’en admettent pas moins une stricte hiérarchie dans l’ordre de la religion et de la chaîne initiatique. De Dieu au dernier des prieurs (faqîr) en passant par l’Envoyé d’Allah (rasûl Allâl), le Recours (al-gawt), le Pôle mystique (al-qotb), l’intercesseur (al wâli), le maître (as-sayh), le docteur en théologie (alîm, pluriel ulamâ), le juris-consulte (faqih) etc … la suite des autorités mystiques et pratiques de la religion est exactement répertoriée et classée sans pour autant s’ossifier en institutions formalisées. La croyance a ses desservants, mais ils ne peuvent exciper trop loin leurs titres pour imposer une autorité particulière de leur opinion. Un outsider peut toujours surgir et contester l’interprétation, au moins en principe …
2– LES CROYANCES MODERNISTES
Au Maroc, la Science et la Religion ne s’opposent pas comme deux registres exclusifs de la connaissance. Bien au contraire, la religion encourage l’approfondissement de la science, et le même mot ( ilm) est utilisé pour dénommer la science spirituelle, la théologie et la science de l’univers tangible. Conditions favorables d’une interaction idéologique permanente d’où une légitimation théorique de tout effort scientifique de connaissance. L’approfondissement scientifique ne va pas contre la religion; il n’a pas à accumuler des preuves, à s’installer dans la clandestinité ou provoquer le scandale, tant qu’il ne touche pas aux pratiques sociales et au domaine de la cité. Cette situation de portes ouvertes – au moins pour la science de l’univers matériel – place le scientifique parmi les savants docteurs de statut déjà reconnu.
N’ayant pas à lutter pour sa légitimation, la science moderne et plus spécialement la technique – largement importée – a obtenu d’emblée tout le champ possible. Aucun ostracisme ou scrupule n’interdit aux Musulmans d’utiliser les conquêtes de la technique, ainsi qu’on peut le voir avec les micros dans les mosquées, les hauts-parleurs aux sommets des minarets pour appeler les fidèles, la photographie des Lieux-Saints etc… Les seules limites sont celles qui, transgressées, pourraient transformer l’ordre social, plus précisément qui seraient perçues comme ayant un tel effet à court terme. Ainsi du calendrier: le comput des jours au Maroc, au moins pour l’année islamique, se fait à partir des phases de la lune. Bien entendu, la connaissance astronomique de celles-ci permet de savoir en tel lieu quand apparaît la nouvelle lune. Mais la tradition veut que le témoignage oculaire de douze Musulmans soit nécessaire pour déclarer le début du mois.
Il s’en suit qu’on ne sait jamais, même la veille, à quelle date du temps universel sera tel jour du mois musulman, telle fête… Car le système social tient fortement à déclarer ce qui a tant d’importance pour la société: la gestion du temps.
La technique peut tout, elle est jugée parfois inconsidérément capable de tout, sauf si elle doit agir sur la société. Proposition plus que contradictoire, absurde même ainsi exprimée, mais qui introduit une coupure fondamentale entre ce qui est possible et ce qui est acceptable. La science est fétichisée en ce sens qu’il n’y a pas lieu de connaître ses limites; elle n’en a pas, justement parce que le respect des limites est prévu dans leur application au social. Au plus lointain qu’elle repousse l’horizon de ses connaissances, la science ne fait qu’expliciter, qu’interpréter, que commenter, ce qui déjà est inscrit dans le Coran. Toute la science est prévue dans le Livre ! On a pu le voir lorsque les expériences astronautiques ont fait découvrir qu’une interprétation du texte sacré était susceptible de montrer que «les ciels pouvaient être ouverts» et que l’homme pouvait parvenir au quatrième, où la lune se trouve sertie.
Car si l’effort permanent et illimité de l’homme pour comprendre la parole de Dieu est exactement ce qu’il y a de plus légitime à entreprend re sur cette terre, il y a loin entre l’entendement et l’action.
L’avenir est loin d’être radieux. Il n’est ni déchéance régulière, ni conquête permanente. Ne se succèdent que des événements, des situations sans queue ni tête, par quoi l’homme et sa société sont éprouvés. Vision largement cyclique, aléatoire avec des progrès, des crises, des catastrophes, des succès, jamais définitivement acquis, jamais totalement perdus. S’il y a un âge d’or, ce pourrait être à la rigueur aux premiers temps de l’Islam.
Les conquêtes de la science et de la technique sont d’heureuses occasions, dont il faut profiter, tant qu’elles existent. Rien n’est écrit au ciel qui garantisse leur durée.
Paul PASCON
Rabat, le 5 octobre 1980
Encyclopédie des Mythes et des Croyances, Lidis, mars 1981
[1] L’observateur le moins prévenu répugne vite à enfermer tout un peuple dans une catégorie uniforme de croyants ou de pratiquants. Dire: «Les Marocains pensent que…», est une réduction insupportable qui ne peut être acceptée que pour comparer avec d’autres peuples, ou d’autres temps, au prix d’une schématisation excessive. Nous pardonnera-t-on de le faire ici au moment où les élites scientifiques de tous les pays s’avancent vers une unification culturelle universelle ?
[2] Une demi-centaine d’ouvrages sérieux ont été écrits sur ces questions au Maroc par des étrangers au pays, et une bonne vingtaine d’ouvrages arabes ont été traduits. Les livres les plus accessibles en français sont ceux d’Edward Westermarck, Survivances païennes dans la civilisation mahométane, Payot 1935; Edmond Doutté, Magie et religion dans l’Afrique du Nord, Alger 1909 et Emile Dermenghen, Le culte des saints dans l’Islam maghrébin, Gallimard 1945; à quoi il faut ajouter la Doctoresse Legey, Essai de folklore marocain, Geuthner, Paris 1926.
[3] cf. Henri Basset, Le cultes des grottes au Maroc, Alger 1920.
[4] qnadel: chandelles.
[5] cf. Henri Basset, idem. pp. 34-38 et Léon l’Africain, Description de l’Afrique, Schefer, Paris 1897, t. II pp. 161-62.
[6] Les tolba sont de jeunes adultes qui se consacrent à l’étude du Coran, à sa lecture, récitation et enseignement de celui-ci dans les petites écoles rurales traditionnelles. Entrepreneurs indépendants de la sorcellerie et des pratiques magiques, ils ne répugnent pas à l’étude de vieux manuscrits d’alchimie, de grimoires et carrés divinatoires, et sont gratifiés de connaissances ésotériques qui confinent à la magie. C’est dans les médersas du Sous que se rencontrent le plus grand nombre de ces tolba issus de familles besogneuses ou déshéritées.
[7] L’hébreu ancien et l’araméen utilisaient la valeur numérale des lettres; on le retrouve en latin avec les chiffes dits romains, en arabe avec l’abjid et l’ayqâs. Cf. Georges lfrah, Histoire universelle des chiffres, CNRS et Seghers, Paris 1981.
[8] Le calendrier d’Ibn Al Banni’ de Marrakech (1256-1321 JC) traduit et annoté par HPJ. Renaud, Larose, Paris, 1948, voir aussi Le calendrier de Cordoue publié par R. Dozy, Brill, Leiden 1961.
Ficher PDF