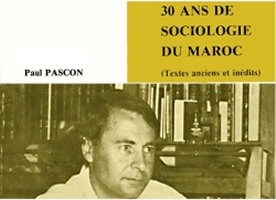30 ans de sociologie au Maroc (1986)
Paul PASCON
Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II

Entretien avec Tahar Benjelloun (1979), Paul PASCON
Q.1 – Qu’est-ce, pour un Marocain, que la terre, l’eau …?
– Question bien générale. Il est difficile de donner une réponse unique, valable pour tout le Maroc. Il y a des régions – dans le Sud – où la disposition de l’eau est tout à fait vitale. En d’autres régions – dans le Nord – les précipitations naturelles sont assez abondantes et bien réparties pour que ce soit la terre qui devienne facteur stratégique de la production. Et encore cette manière de présenter les choses répond mal à des situations concrètes très variées: en montagne par exemple le partage des eaux peut être de type collectif, apparemment très égalitaire, mais c’est la terre, conquise grâce à un considérable effort humain, qui est très inégalement répartie. On trouve aussi d’autres cas, où la terre et l’eau sont très concentrées en un petit nombre de mains, mais pas forcément les mêmes.
En se plaçant d’un point de vue historique, disons que très anciennement l’eau a toujours été un facteur prépondérant dans les régions arides et désertiques, alors que la terre n’est devenue vraiment un bien rare qu’avec la prédominance de l’agriculture sur l’élevage. Cependant je ne suis pas de ceux qui pensent que la propriété individuelle de la terre soit un fait récent partout au Maroc. J’ai traduit ces derniers temps un polyptyque datant de la fin du XVIème siècle concernant les propriétés d’un seigneur du Sud-Ouest, en pleine zone aride, qui montre à l’évidence que la propriété de la terre est autant recherchée que celle de l’eau. Évidemment, il est toujours question dans ces sortes de documents de terres situées à proximité des sources d’eau, mais tout de même on peut constater 1) la distinction des deux types de propriété, 2) l’égal intérêt porté à l’acquisition de l’un et de l’autre des deux facteurs principaux de la production à cette époque déjà.
Hors certains cas sur lesquels nous commençons seulement à avoir quelques lueurs (concessions foncières du pouvoir politique, acquisitions onéreuses dans les banlieues des villes, dons gracieux et biens de mainmorte ..) on doit admettre que la propriété privée donnant lieu à des actes authentifiables opposables à des tiers, était plus répandue, avant le XXème siècle, pour l’eau et pour les arbres, que pour la terre. Ce qui ne veut pas dire que la terre n’était pas occupée, cultivée et probablement possédée privativement, mais certainement au sein de groupes de voisinage. Depuis 1912 – début du Protectorat – et surtout depuis
(*) Texte inédit, prévu pour le journal le Monde, 24 janvier 1979.
1956 avec l’Indépendance, c’est une toute autre affaire. Le Maroc est devenu un pays où l’agriculture l’emporte de plus en plus sur l’élevage – évolution certainement excessive d’ailleurs – et où la propriété privée de la terre, même en zone semi-aride et subhumide est prépondérante. Ceci devient patent, simplement au vu de l’extraordinaire croissance de la valeur des transactions foncières comme au vu du niveau de la rente foncière. Dans le Maroc des grandes plaines atlantiques, la rente annuelle de la terre nue était vers les années 20 de l/7 à l/6 de la production brute. Aujourd’hui, il y a peu de terres, si mauvaises qu’elles soient, baillées au-dessous du tiers de la récolte brute; souvent la rente est de la moitié et même l’excède.
Avec l’exécution des grands barrages d’accumulation par l’État, l’eau par contre a perdu, ou plutôt perd progressivement, son ancienne qualité de facteur stratégique dans les zones arides et désertiques. Car l’eau est aujourd’hui desservie aux particuliers au prorata de la superficie dont ils disposent. Ceci ne peut que renforcer la prépondérance de la propriété privée de la terre dans la compétition sociale.
Quant au travail humain, s’il a pu être autrefois un facteur rare, la croissance démographique et le rajeunissement formidable de la population ont fortement modifié sa capacité de négociation. Mais il y aurait beaucoup à dire sur cette première réponse schématique et j’espère pouvoir mieux m’expliquer là-dessus tout à l’heure.
Le capital, enfin, est encore un facteur modeste de la production agricole, sauf dans les fermes capitalistes modernes: environ 10 % du territoire cultivé. L’agriculture marocaine est encore aujourd’hui une agriculture paysanne. Mais les choses sont en train de changer à grande allure. On ne pourra peut-être pas tenir le même langage dans une dizaine d’années.
Q. 2- Où en est la situation agraire au Maroc depuis l’indépendance ?
– Si dans votre question il faut entendre que le qualificatif «agraire» se rapporte expressément à la répartition des terres agricoles, je crois qu’on peut résumer l’histoire agraire des 23 dernières années par la succession de quatre phénomènes: la dévolution des terres de colonisation, la naissance de nouveaux «colons» marocains, la création d’un secteur de Réforme Agraire, une course plus récente à la terre encore bien indécise.
Au jour de l’Indépendance, la colonisation étrangère disposait à peu de choses près d’un million d’hectares cultivés dans les plaines situées au Nord de l’Atlas et dans le Sous. Au contraire de ce qui s’est passé en Tunisie, et surtout en Algérie avec le phénomène de la «vacance» des colons, le Maroc n’a récupéré la propriété des terres détenues par les étrangers qu’avec beaucoup de précaution, de temps et de palinodies. Il a fallu près de dix-sept ans pour que les dernières terres exploitées par les colons soient reprises par l’État (2 mars 1973). Il y a à cela bien de bonnes et mauvaises raisons mêlées. Le Maroc est, et était encore davantage, un pays où l’agriculture dominait l’économie. Sans doute les colons exportaient, réglementairement ou non, l’essentiel du surplus de leurs exploitations – en tous cas pour la grande colonisation c’était la règle-.
L’État marocain avait donc là de bonnes raisons pour accélérer la récupération de biens qui exportaient la richesse. Mais les dirigeants du pays craignaient au plus haut point une chute de technicité avec le départ des colons qui auraient eu pour conséquence un effondrement de la productivité et de l’économie générale. En troisième lieu, hors quelques slogans peu précis, les partis politiques avaient peu réfléchi aux solutions et aux cadres de la récupération de ces terres. La seule expérience que nous avions était celle … des autres pays – socialistes pour la plupart, c’est-à-dire dans des conditions socio-politiques bien différentes, avec des moyens psycho-politiques tout à fait inverses qui impliquaient la révolution sociale tout simplement. Une révolution agraire socialiste dans le Maroc de 1960, c’était un peu de la politique-fiction. Quoique la générosité des utopies socialistes fascinât la plupart des acteurs du moment, un certain nombre doutait de leur efficacité pratique s’ils ne remettaient pas en question leurs effets sociaux. En l’absence d’industrie et de production minière suffisante, la prudence était de protéger l’agriculture de toute aventure inconsidérée. Voilà pour les «bonnes» raisons, qui ont fait reculer la reprise des terres et en ont étalé les cœurs.
Les «mauvaises» raisons ne sont pas toutes connues dans le détail. Les colons n’étaient pas sans influence dans les milieux dirigeants traditionnalistes et conservateurs, mais ils étaient de moins en moins soutenus par le Quai d’Orsay, si l’Ambassade de France ne les décourageait pas. Les autorités françaises ont conseillé aux colons d’abord de rester, et même d’investir après 1963, de ne pas céder à la tentation d’un départ précipité. Plus subtilement, le pouvoir s’avisait, ou était avisé, que ce million d’hectares pouvait constituer la base économique d’une classe sociale fort capable d’encadrer la campagne, et de succéder aux anciennes élites locales traditionnelles provisoirement discréditées. Mais il fallait trouver dans le Maroc des années 60 des entrepreneurs modernes – donc à l’époque surtout citadins – capables de jouer ces rôles. On trouvait alors davantage de spéculateurs que de gentlemen-farmers. Il fallut du temps pour les susciter. D’où cette valse-hésitation dans la «reprise», le découpage du fonds détenu par la colonisation en statuts fonciers multiples, l’étalement de la reprise par statut et par régions pour pouvoir contrôler, choisir, orienter et créer cette classe de grands propriétaires fonciers. C’est aujourd’hui chose faite: 45 % de la superficie des terres de colonisation est maintenant détenue par de grands propriétaires marocains, capitalistes sinon vraiment «modernes»; en tous cas, il s’orientent résolument vers une agriculture de grande ferme tournée vers le dégagement d’un profit maximum.
Q.3- Et la Réforme Agraire ?
R- Ce fut d’abord, avec l’indépendance, un slogan révolutionnaire des partis nationaux: La terre à ceux qui la travaillent! Ils visaient une confiscation des latifundiaires et des colons en vue d’une redistribution aux tenanciers et aux ouvriers. À partir de 1961, l’Administration récupéra progressivement le concept de plus en plus affadi dans ses projets: Charte agricole, Réforme Agricole, Code des Investissements Agricoles. En 1966, le Ministère de l’Agriculture était chargé de procéder à la Réforme Agraire, mais il ne s’agissait plus que de la distribution des terres reprises à la colonisation et conservées par l’État. La Réforme était réduite à opérer un lotissement dans les «meilleures conditions techniques possibles». Pas de bouleversements sociaux donc, l’objectif était «d’enrichir les pauvres sans appauvrir les riches». Plus pratiquement, l’Administration visait à créer un symétrique à la nouvelle classe des propriétaires capitalistes qui lui soit également attaché, une classe de petits exploitants agricoles privilégiés et pupilles de l’État. Une classe-tampon entre les grandes fermes et la masse des chômeurs ruraux. C’est ainsi que de 1966 à 1978 près de cinq cent mille hectares ont été distribués en location-vente à près de 60.000 agriculteurs sans terre. Il y avait, en 1971, environ 700 000 adultes masculins sans terre; la Réforme Agraire a donc permis d’en caser un peu moins de 10 %. Les 5 000 heureux attributaires annuels en moyenne durant cette période, représentent également moins de 10 % du nombre de ruraux masculins qui arrivent à l’âge de l’activité chaque année. La Réforme Agraire n’est donc pas une opération sociale. Elle ne peut guère avoir d’effets économiques décisifs: c’est une opération politique, quoique les sous-entendus de la Loi de Réforme Agraire visent des objectifs de production. Politique, en effet, en raison du petit nombre en chiffres absolus et relatifs de l’effectif concerné par ces distributions et surtout en raison du cadre du choix. Les candidatures à l’allotissement sont faites au sein des Communes Rurales (2 à 5 000 foyers environ, soit 1 000 à 3 000 foyers «insuffisamment pourvus en terre», donc bénéficiaires potentiels). Souvent moins de 10 % des candidatures exprimées sont en définitive retenues à partir de critères objectifs généreux (âge, pauvreté, métier, nombre d’enfants, alphabétisme …). L’effet psychologique est celui d’une loterie: beaucoup espèrent accéder enfin à la terre … la fois suivante, s’il en reste à distribuer. Ceci maintient une atmosphère d’attente et de regards tournés vers le ciel.
Sur les 500 000 hectares distribués – 7 % du territoire cultivé – les résultats économiques cependant ne sont pas à négliger, ni non plus certains aspects socio-politiques inattendus. La preuve est faite dans le secteur de la Réforme Agraire que les investissements et le crédit au profit des petits producteurs, autrefois considérés comme traditionnels et archaïques, donnent de bons résultats, c’est-à-dire que la productivité y est égale, voire supérieure à celle des secteurs qui ne bénéficient pas, ou peu, de la sollicitude de l’État. En outre, les attributaires des lots de Réforme Agraire, obligés de s’enrôler dans des «coopératives» de services, apprennent de nouvelles solidarités, élargissent leur horizon économique et social, et commencent de constituer des forces locales non négligeables dans les quelques régions où le phénomène est le plus ancien. Rien de bien spectaculaire sans doute, mais où trouve-t-on ailleurs cette nouveauté ?
Q.4 – A votre avis aujourd’hui assiste-t-on plutôt à une concentration de la terre ou à une certaine redistribution ?
Il est assez difficile de dire quel est le bilan de ce double phénomène – concentration/distribution. D’abord parce que les statistiques foncières sont trop indigentes. On sait bien ce qui s’est passé pour le million d’hectares récupérés sur la colonisation. Pour le reste, on a seulement des données régionales fragmentaires et datées. En telle région, il y a concentration indiscutable avec prolétarisation: je pense au Rharb notamment et au Tadla. Dans telle autre région, les opérations de distributions, les sorties d’indivision, l’éloignement des villes et des centres industriels, créent des conditions qui équilibrent les transactions foncières au profit des grands propriétaires. Je crois que personne n’a vraiment de réponse générale justifiable avec des sources documentaires acceptables. Situation propice donc à des déclarations de sentiments et non à des discussions objectives.
D’autant plus que nous sommes dans une période de très forte croissance démographique. Malgré l’urbanisation, l’exode rural, l’émigration, le nombre de foyer ruraux continue d’augmenter très rapidement. L’industrie marocaine est actuellement peu créatrice d’emplois, en tous cas n’est pas en mesure d’absorber le surplus d’actifs de la campagne.
L’insécurité de la mise en valeur corrélative à la concentration de la terre et l’existence de plus d’un million d’hectares de terre sous statut réputé collectif, rendent l’exploitation agricole marocaine précaire sur probablement plus du tiers de la surface nationale cultivée. Les «terres collectives» dont le statut dérive d’une loi de 1919 désuète mais non abrogée menace sans cesse les ayants droit qui les occupent de fait, de réaménagement foncier. L’indivision, la dispersion des parcelles, les échanges et les baux accroissent encore le nombre et la surface des exploitation qui sont gérées à l’année. Cette précarité, autant que la faiblesse des prix agricoles à la parcelle, est fort probablement la cause principale de la stagnation de la productivité sur plus des trois quarts du territoire national, c’est-à-dire en dehors du secteur de la Réforme Agraire et du secteur capitaliste.
Q.5 – La population croît, l’industrie ne peut absorber tout le surplus démographique des campagnes. Est-ce qu’au moins la productivité de la terre progresse ?
Certainement. Rapporté à l’hectare, il y a un progrès de la productivité indiscutable. Rapporté au travail humain, à l’emploi, per capita, c’est plus difficile de l’affirmer. Sur les terres coloniales récupérées, après un fléchissement, et même en certains endroits une réelle régression, la productivité à l’hectare est remontée en volume physique. Dans le reste du pays, il y a eu aussi progression. Nous sommes bien loin du temps où il fallait convaincre les agriculteurs de l’avantage de l’emploi des engrais et des semences sélectionnées. Aujourd’hui, le paysan marocain aspire à l’utilisation de moyens modernes de production. C’est l’État, c’est le marché qui ne sont pas en mesure de répondre à son attente. La centralisation des pouvoirs sur la technique et sur la disposition des intrants modernes soumet la diffusion de ceux-ci à des décisions bureaucratiques; alors qu’il est certain et éprouvé que les associations agricoles et professionnelles seraient en mesure en quelques années de prendre le relais d’instances aujourd’hui dépassées par l’évolution générale. Ce sont des idées qui circulent un peu partout, mais qui n’ont pas encore de prise sur la réalité.
Plus profondément, les conditions d’accès à des techniques plus productives ne manquent pas de préoccuper les agriculteurs: les intrants sont de plus en plus coûteux et les rendent de plus en plus dépendants du marché international. Ce n’est pas une situation propre au Maroc, bien entendu. Mais le fait qu’il faut de plus en plus de quintaux de blé pour payer le même tracteur, le fait que l’accroissement des dépenses est de moins en moins bien payé par un accroissement corrélatif des revenus, retiennent les agriculteurs sur la voie de l’utilisation des facteurs de production les plus efficients.
Prenons la question des tomates. Le Maroc bénéficie d’un avantage climatique de précocité de 15 à 30 jours en moyenne sur le Sud de la France, parfois même un peu plus selon les années. L’entrée de l’Espagne, du Portugal, de la Grèce dans le Marché Commun, entraînera l’érosion de cet avantage. Jusqu’ici la tomate marocaine était, pour l’essentiel, produite en plein champ avec une productivité plus réduite qu’en Europe certes, mais l’avantage de la précocité était décisif, en tous cas suffisant. Demain, le Maroc sera contraint de produire sous serres- il a commencé d’ailleurs, efficacement – c’est-à-dire qu’il sera contraint d’accroître considérablement l’investissement et sa dépendance à l’égard de l’Europe, car une partie importante des intrants seront importés. Une telle évolution entraîne aussi en France des difficultés pour les agriculteurs, mais au moins crée-t-elle des emplois dans le secteur industriel, dans le même espace économique national.
Au Maroc, la dépendance économique à l’égard des grandes puissances industrielles est telle que la demande supplémentaire d’intrants ne peut être que défavorable à l’économie générale du pays, tant que ces intrants ne sont pas élaborés sur le sol national.
Q.6 – Vous avez fait, il y a maintenant dix ans, une enquête sur la jeunesse rurale, et vous mettiez en évidence un certain désabusement, sinon un refus de la situation créée au jeune à la campagne. Seriez-vous toujours d’accord avec cette conclusion ? En d’autres termes, quelle est la situation des jeunes à la campagne aujourd’hui ?
– Il y a dix ans, avec Mekki Bentahar et quelques chercheurs, nous découvrions un phénomène nouveau concernant la jeunesse rurale au Maroc : la monétarisation des rapports de production, et en particulier le fait qu’un nombre sensible et croissant de jeunes refusaient le travail chez leurs pères parce qu’il n’était pas rémunéré. C’était alors un phénomène en germination. Aujourd’hui je n’ai pas les moyens factuels de mesurer sa progression. Mais je crois pouvoir dire que dans les grandes plaines du Nord de l’Atlas, il est de règle qu’après 15-16 ans, un jeune ne travaille plus comme autrefois dans l’exploitation familiale.
L’extraordinaire développement des petits centres et leurs effets sur les modèles de comportement, la relative liberté – menacée – qui règne, le cinéma, la télé, le tabac…potentiel sinon accessible, attirent souverainement les jeunes en quête de n’importe quel expédient. Au village, les salaires ont tendance à s’établir au niveau urbain, sans exactement y parvenir. Si ces salaires sont très supportables pour les grandes exploitations, pour les micro-propriétaires ou simplement les exploitations paysannes, de tels salaires sont incompatibles avec les conditions de la valorisation de la production. Jusqu’à 15 ans, les parents parviennent à retenir leurs fils au prix de leur seul entretien Au-delà de cet âge, la solidarité familiale n’est plus tout à fait suffisante pour empêcher le jeune d’aller se placer ailleurs.
Mais les considérations économiques, pour principales qu’elles soient ici, ne sont pas les seules. De nouveaux usages sont en train de naître. Les jeunes acceptent de moins en moins d’être exploités au su et au vu de ceux qui les connaissent. Inconnus dans d’autres contrées, ou dans les petits centres, ils sont prêts à être plus exploités encore sous l’empire de la nécessité immédiate, mais pas chez eux.
Les conséquences sont d’une part la juvénilisation du travail agricole avec la menace que ceci fait peser sur le niveau de la technicité et de la scolarisation, et de l’autre une monétarisation des rapports sociaux plus rapide que l’organisation du marché de la production. Ces phénomènes accroissent la sensibilité des exploitations paysannes aux problèmes de trésorerie et d’équilibre économique.
7 – En tant que sociologue, vous faites donc des observations sur les campagnes au Maroc. Quels sont les effets de ces remarques ? Plus généralement, quel rôle politique joue le sociologue dans un pays du Tiers-Monde ?
R.- La sociologie rurale marocaine, celle de l’indépendance, celle des nationaux est encore bien jeune. Son influence n’est guère sensible au-delà de cercles très étroits d’universitaires, de cadres de l’Administration ou de politiciens citadins pour la plupart. Elle n’est pas encore parvenue à se dégager de son environnement proprement universitaire, ni à être réellement indépendante des pouvoirs publics. Cela ne veut pas dire qu’elle soit strictement astreinte; mais enfin les seules études possibles sont celles qui sont autorisées, ou mieux encore commandées.
Le gros retard est dans l’extrême difficulté que les sociologues ruraux au Maroc rencontrent à faire participer les paysans à la définition même des Problèmes étudiés. Nous aimerions bien au fond que ce soient les ruraux eux-mêmes qui posent les questions et nous demandent de leur fournir les informations, plus générales qui leur manquent. Aujourd’hui nous jouons trop un rôle inverse, un jeu dangereux au fond, mais sans lequel il n’y aurait pas de sociologie rurale du tout. En fait, nos études – bonnes ou mauvaises – augmentent le pouvoir des ingénieurs, des bureaucrates et des politiques. La collecte d’informations, la construction de modèles d’explication qui enjambent les considérations partielles que peuvent seules appréhender la plupart des ruraux aujourd’hui au Maroc, tout ceci crée de nouvelles réalités, de nouvelles «vérités» censées être plus rationnelles, mais de plus en plus séparées de la rationalité populaire. Les sociologues sont responsables de l’extraction d’une matière première brute: l’information, et de son retour probable sous la forme élaborée d’actions étatiques. Je dis que dans le stade actuel, il est probablement difficile de faire autrement. La sociologie marocaine est encore une sociologie de classe au profit des dominants, en définitive peu différente de la sociologie coloniale. Mais, ou bien on renonce à partir des faits et on se réfugie dans une logomachie dogmatique, ou bien on prend les risques inhérents à l’approche du réel dans une situation politique générale peu favorable aux masses populaires. Nous sommes quelques-uns à penser que cette voie est la meilleure, en attendant que le rapport des forces sociales permet de tirer un meilleur profit de la masse documentaire réunie. Entre temps, d’autres se serviront de ces documents ?
Nous n’avons crainte qu’ils en fassent un trop constant usage: les sociologues au fond dérangent plus qu’ils ne servent. Les dirigeants aiment les recettes peu coûteuses, à effets immédiats. On ne trouve guère ce genre de marchandise miracle dans les études jusqu’ici publiées.
Q.8 – Mais vous, plus personnellement, en quoi consiste votre travail ? Quels sonts vos objectifs ?
R.- Je suis enseignant dans un Instit ut Agronomique et Vétérinaire. Mon enseignement porte sur la sociologie rurale marocaine. Je poursuis des recherches personnelles dans ce domaine, et j’alimente mes cours avec ces études. Je tente avec quelques autres de créer les conditions d’une meilleure approche personnelle des problèmes ruraux par mes étudiants et mes collègues en organisant, dans le cadre de l’Institut, des stages sur le terrain. L’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II offre de ce point de vue des conditions exceptionnelles dans un pays comme le Maroc: les étudiants peuvent en effet résider de nombreuses et longues périodes chez les agriculteurs, très librement et en l’absence de tout formalisme administratif. Nous sommes loin d’avoir retiré encore tous les avantages pédagogiques humains d’une telle situation, mais nous progressons, je crois, dans ce sens.
Q.9 – Y a-t-il de plus en plus de chercheurs et étudiants marocains qui se dirigent vers l’étude de la société rurale ?
R.- Oui, c’est indéniablement le ruralisme qui est actuellement le secteur le plus attractif pour les chercheurs en sociologie. J’en suis personnellement très satisfait et en même temps je regrette que d’autres secteurs tout aussi importants ne soient pas actifs.
Il y a des raisons historiques et politiques à cela. Le monde rural a longtemps dominé la société marocaine. Sous la colonisation, l’ethnologie, l’anthropologie privilégiait l’étude de la campagne, disons-le, des formes les plus «archaïques» de la société. Nous héritons déjà de ce courant. Avec l’indépendance, l’agriculture a été très tôt déclarée secteur prioritaire. Les premières études n’ont pas porté sur l’habitat, l’industrie ou le tourisme, mais sur le développement rural. Les premières équipes de recherche constituées par le gouvernement indépendant comprenaient systématiquement un sociologue.
Aujourd’hui, il y a une douzaine de sociologues ruraux au Maroc. C’est peu pour un pays où la campagne pèse d’un tel poids dans la société civile, mais il n’y a pas d’effectif comparable dans les autres spécialités.
L’urgence aujourd’hui est de sortir la sociologie rurale de l’étude des situations marginales et de l’orienter fortement vers les secteurs ruraux en pleine transformation.
Q10 – Quelles sont les autres sociologies qui vous paraissent devoir être développées ?
R- La sociologie urbaine bien sûr. La sociologie de la famille aussi. Ces deux spécialités sont en train de devenir attractives avec les études sur la situation de la femme. Mais je m’étonne que la sociologie de l’Administration, de l’État n’ait pas été ouverte, ni celle de la pratique religieuse. Il y a bien un chercheur marocain qui a inauguré la sociologie des partis politiques, mais il y aurait encore beaucoup à faire. La sociologie de la Communication attend un initiateur. D’autres domaines comme la Jeunesse, les sociabilités, la délinquance, …
Q11 – Comment le pays reçoit-il les implications de la politique générale qui se décide loin de lui ?
R- Bien sûr, la plupart des décisions de politique économique sont très centralisées. Que dis-je ? centralisées, situées hors du territoire national. Le Maroc est très largement dépendant du financement international. On ne fait pas qu’emprunter des capitaux. Avant, pendant, après l’investissement il y a des «experts qui se penchent sur les projets», et ceux-ci sont chargés au minimum de faire des suggestions, au plus de rédiger eux-mêmes, les «requêtes» et les conditions de ces requêtes … On emprunte donc aussi des idées. Il y a probablement une certaine cohérence entre la succession des idées que véhiculent séparément et successivement la Banque Mondiale et chacun des financements bilatéraux des pays industrialisés et pétroliers, mais une cohérence au profit de qui ?
Au niveau plus immédiat de l’exécution, la population «bénéficiaire» ne peut même pas percevoir les éléments de cette cohérence, et l’administration exécutante pas plus qu’elle. Il y a une série d’actions dont la justification enjambe et dépasse les particuliers et les groupes locaux. Tout le jeu consiste pour les acteurs sociaux à tirer le meilleur parti personnel de ces aubaines, de ces contraintes, de ces aléas. Il serait vain de se demander avec le peu d’informations dont elles disposent, comment les populations concernées peuvent se faire une opinion rationnelle.
Q12 – Mais les députés ruraux, sont-ils alors de purs figurants ? Ne peuvent-ils être les porte-parole de la population ?
R- La plupart des représentants n’ont pas été élus sur la base de programme d’action, mais sur l’appartenance à des réseaux de fidélité. Peu de candidats ont fait campagne sur la base d’un projet de politique générale. Je n’ai pas de chiffres précis en tête, disons qu’un tiers seulement a été élu au nom de partis politiques affichés. Mais plus grave encore, très peu ont fait campagne sur la base d’un programme précis d’action au profit de leur circonscription. Plus précisément encore, les votes ont trop souvent, à la campagne, ignoré les programmes et se sont portés sur les personnalités et leurs liaisons avouées ou non à telle ou telle étiquette. De sorte que les élus ne sont guère tenus de réaliser le moindre projet.
Ceci dit, il s’en faut de beaucoup que les élus, même proches du gouvernement approuvent du fond du cœur les choix effectifs d’actions que l’administration a préparées souvent avec beaucoup de discrétion, et même sans malice. Les projets sont là ! Finançables, proposés en bloc dans un budget. Ce n’est jamais le moment de remettre en question ce qui a été délibéré ailleurs. N’étant pas à la source du pouvoir et n’ayant pas la décision d’entreprendre, il serait malvenu et tout à fait inefficace pour les élus de renvoyer les projets. On explique que cela n’est qu’une situation provisoire, un stade de mise en train, et que mieux préparés et mieux entraînés «ils» participeront, voire !
Q13 – On a l’habitude d’entendre dire que les ruraux sont des Musulmans plus pratiquants que les citadins. Croyez-vous que l’Islam se renforce dans les campagnes plus que dans les villes ?
R- Écoutez, je suis loin d’être un spécialiste de ces affaires et je suis personnellement très peu qualifié pour porter un jugement là-dessus. Il n’y a pas d’études sérieuses dans ce domaine. Je n’ai sur cette question au fond que des idées générales, des … croyances subjectives. Je pense que les ruraux vivent leur foi différemment que les citadins, ce qui n’introduit aucun jugement sur leur plus ou moins de foi. Les activités rurales sont plus compatibles avec les coutumes pratiquantes dans ce Finistère de l’Islam, que les nouvelles activités citadines. Les horaires, le rythme de travail, la présence de la nature, la vie culturelle, l’horizon quotidien des édifices et des lieux, sont plus propices à la religiosité traditionnelle. C’est aussi vrai pour les médinas traditionnelles, mais davantage menacées par le siècle. Dans les villes nouvelles, dans les bidonvilles, les petits centres, la situation est tout à fait déchirante économiquement, socialement, moralement, et il est naturel qu’il en soit de même du point de vue religieux. Localement les pratiquants sincères n’ont aucun autre modèle à proposer que la forme traditionnelle. Il n’y a pas eu jusqu’ici d’innovations, de formes spécifiques pour donner une autre pratique à la même foi, et fournir une réponse crédible aux interrogations du siècle. L’Islam ne peut se pratiquer que comme il y a un siècle, des siècles: et tout a tellement changé que seuls ceux qui vivent encore comme autrefois sont en mesure de vraiment respecter la tradition, dans les gestes admis de la religion.
Pour retenir les modernes dans la pratique religieuse, les bonnes paroles ne suffisent pas. Il faudrait qu’il existât de nouveaux modèles prestigieux, des activités, des lieux nouveaux, des volontés bénévoles … Ces absences expliquent peut-être des germinations profondes et souterraines de rigoristes intolérants.
Q14 – Que pensez-vous de la manière dont les marabouts sont utilisés aujourd’hui comme substituts des asiles ?
R- Je crois voir à quelles situations précises vous faites allusion. Je pense qu’il faut placer cela dans le cadre plus général des fonctions des activités mystico-religieuses dans la société dite traditionnelle, c’est-à-dire dans la société laissée en marge de la modernisation, dans les zones prolétarisées, où les confréries religieuses assurent justement certaines des fonctions que l’État moderne censé être omnipotent est incapable d’assumer. Sans doute la compréhension du phénomène ne peut se réduire à ses seuls aspects fonctionnalistes mais enfin dans le cadre de cet entretien, j’en resterai là.
Comme tous les hommes, les ruraux au Maroc cherchent des réponses à leurs interrogations. Devant l’étonnante transformation du monde, ils ne peuvent interpréter eux-mêmes les textes sacrés ; ils doivent passer par le commentaire de spécialistes si je puis dire. En Islam, il n’y a pas vraiment de clergé. En théorie, tout homme suffisamment instruit peut s’autoriser à expliquer le message. En pratique, c’était jusqu’ici les Chorfa et les saints qui le faisaient, non tant d’ailleurs par la tenue de «séances» didactiques, mais par leur comportement, leurs attitudes, leurs conseils. Ces santons, qui ont hérité de l’aura de leurs ancêtres, soignent l’inquiétude populaire par la montre, l’extase, la fête, la communion. Il existe dans chaque région toute une série très complète d’administration du charme, du charisme, et tout rural sait où s’adresser si sa femme n’a pas d’enfant, si l’eau du Ciel tarde à tomber… La mise au point de ses charmes n’est pas un fait unilatéralement manipulé par le santon, elle est le résultat, sorti du fond des âges, de rapports dialectiques entre les ouailles qui demandent et les saints qui accordent leurs grâces dans certaines conditions d’épreuves jugées propices à la liquidation de l’inquiétude ou du désarroi. Que certains desservants de sanctuaires abusent de cette situation, c’est un fait d’évidence qui n’est jamais assez dénoncé. Je pense par exemple à l’enfermement scandaleux et clandestin de débiles mentaux. Que soit dénoncée aussi l’utilisation politique de certains moussems (foires religieuses), c’est aussi une question à débattre, encore qu’on ne sache pas trop si certains dirigeants n’encouragent pas ou ne se portent pas à la tête d’effervescences que de toutes manières ils ne pourraient guère empêcher. Mais que l’on condamne le mysticisme parce qu’il n’est ni la vraie religion, ni une thérapeutique rationnelle, je crois qu’il ne faut le faire qu’en apportant des solutions de rechange. C’est plus facile à énoncer qu’à exécuter.
Q15 – Quelle culture prévaut aujourd’hui à la campagne ?
R- Là encore, combien il est difficile de donner une réponse générale! Cela dépend tellement de la région à laquelle on se réfère. Je serais tenté d’affirmer: «une déculture»! Comme si une absence de culture était possible. D’une manière très générale la presse écrite et la télévision n’ont pas encore pénétré dans les campagnes d’une manière suffisante pour y créer des situations nouvelles. La radio et les fêtes traditionnelles sont les manifestations le plus apparentes de la culture. L’école «moderne», inadaptée aux conditions dans lesquelles vivent les ruraux est en quelque sorte une enclave presque extraterritoriale; en tous cas elle ne peut être une source importante de culture. Les écoles traditionnelles (le msid, les médersa-s) perdent progressivement de leur importance et de leur prestige, sauf dans certaines régions particulières: Sous, Rif, Jbala…. La culture repose en large partie sur la transmission orale, vocale. Ceci est séculaire, mais ce n’était pas autrefois combattu par les nouvelles manières de vivre.
Le foisonnement, le bouillonnement de la culture populaire est actuellement indiscutable dans les contes, les récits, les chansons, les adages, les allusions aiguës, les jugements perfides portés sur l’époque, les puissants, les parvenus. Culture dominée, quasi clandestine, souterraine qui déborde parfois dans les reprises édulcorées de groupes folkloriques ou des formations à la mode – je pense aux premiers temps des Jil Jilala et des Nass al-Ghiwane. Il y a des trouvères, des troubadours, des «flatteurs» (meddaha-s) qui ensemencent toute une vallée, toute une région, en quelques jours dès qu’un événement d’importance appelle un jugement populaire. Tout cela n’apparaît guère dans la littérature écrite. Les ruraux ne sont pas enfermés dans une culture traditionnelle arrêtée, sclérosée; loin de là, l’autre culture importée, les manières nouvelles l’ont depuis toujours traversée, bousculée. La culture rurale est en marche, mais elle diff use peu au dehors; sauf exception, elle est centripète, alors que la culture urbaine est centrifuge et s’alimente de trains d’ondes renouvelés d’Orient et d’Europe.
Un manque d’écriture marque la culture populaire rurale. Il faudrait des journaux, des journaux écrits par et pour les ruraux. Est-ce un rêve ? L’extraordinaire réussite de Akhbar as-Souq (Nouvelles du Marché) peut faire réfléchir… et craindre la diffusion d’une sous-culture, et encore une domination citadine.
Mais enfin il y a un besoin énorme de lecture à la campagne.
Peut-on éviter de parler de la langue écrite justement? Peu de romans, peu de chroniques, peu d’anecdote sont offerts au public dans la culture populaire marocaine. Entre la poésie échappée vers l’irréel et une langue pénale – celle des discours, des conseils, des ordres, des lois – tout aussi irréelle d’un certain point de vue – il n’y a rien. Qui écrit sur la vie de tous les jours, sur la vie concrète pour aider les lecteurs à se comprendre dans le monde ? Le réalisme n’a pas d’auteur. Pense-t-on qu’il n’a pas de public?
Plus largement, on peut se demander pourquoi la littérature maghrébine de langue arabe n’a connu que le fiqh (exégèse doctrinale de jurisconsultes), l’hagiographie et l’historiographie si l’on écarte quelques auteurs de génie exceptionnels. Serait-ce l’abîme qui sépare la langue parlée de la langue écrite qui explique la rupture entre les clercs et le peuple? La fermeture, le cloisonnement entre culture populaire et culture élitiste est bien connu dans d’autres pays, on peut se demander si le phénomène n’est pas autrement plus grave au Maghreb.
Qui osera le premier engager une littérature populaire en langue parlée ?
Q16 – Et le problème berbère ?
R- Voilà bien le genre de faux-vrai problème que le Maroc, que le Maghreb, traîne encore comme un boulet. On a dit assez la confusion créée par la politique coloniale qui a élargi la distinction entre groupes linguistiques indiscutables (arabophones / berbérophones), en opposition totale de cultures et en une distinction d’alliances politiques. Aucune des dichotomies affirmées -ruraux / urbains, nomades/ sédentaires, pasteurs / agriculteurs, démocrates /autocrates, Makhzen / siba, laïcs / religieux etc… etc .. n’a résisté à l’analyse et n’a donné lieu à des correspondances significatives. Il s’agit bien dans sa totalité d’un montage absurde qu’aucun savant, aucun spécialiste n’a confirmé. Il y a bien au Maroc de grandes variétés de genre de vie et de culture; c’est même une des caractéristiques que la courte occupation coloniale n’a pas permis d’éroder et d’abaisser au niveau de la culture importée. Mais cette variété, cette richesse sont des faits régionaux globaux qui n’impliquent nullement une division de la nation ou une opposition culturelle.
Eh bien, voilà plus de vingt ans que le Maroc est indépendant, vingt ans qu’il a d’évidence balayé ce genre de billevesées, mais la langue berbère n’est toujours pas enseignée, ni même étudiée en faculté parce qu’on craint de réveiller on ne sait quel fantôme de la division nationale créée par le colonialisme. Moyennant quoi, le berbérisme, c’est-à-dire un culte de la différence ethnique et linguistique, s’alimente de ce silence de la culture officielle. Certes il y a de courtes émissions radiophoniques en langue berbère (tamazirt et tachelhit), mais il s’agit soit de folklore musical, soit de la même parole pénale dénoncée tout à l’heure. Rien sur la vie même de cette langue, de cette culture exceptionnelle, rien pour tenter de sauver, de conserver, d’entretenir un patrimoine qui intéresse près de cinq millions de locuteurs, le plus important groupe linguistique berbère dans le monde.
Ce qui n’empêche pas les bazaristes de Marrakech de qualifier de «berbère» un grand nombre de bijoux ou d’objets qui à l’évidence ne le sont pas, mais sont des vestiges de l’artisanat israélite ou de l’artisanat maure, parce que les touristes européens croient berbère tout ce qui au Maroc n’est pas «oriental».
Q17 – Est-ce que l’élite citadine fassie est toujours prépondérante dans l’appareil du pouvoir et des finances ?
R- Globalement oui! C’est une longue histoire. Il faut probablement pour la comprendre remonter jusqu’à la Reconquista, et la venue à Fès, Tétouan, Salé… des grandes familles musulmanes et israélites d’Andalousie. Depuis des siècles ces familles ont dominé la vie culturelle et commerciale de la capitale du Nord. Elles étaient les plus instruites, les plus ouvertes sur le monde, les mieux préparées au commerce international. Quelques traditions du commerce à longue distance en bordure du Sahara se sont perpétuées (Sous), mais d’une toute autre manière – on peut rapprocher ces dernières des pratiques m’zabites ou djerbiennes.
Avec le Protectorat, les élites citadines ont été les premières à concevoir dans son ampleur, au-delà du simple et immédiat patriotisme, les implications de la domination coloniale: sur la culture musulmane et aussi sur leurs activités commerciales elles-mêmes. Là sont nées les premières contestations modernes de l’impérialisme, mais aussi les premiers héritiers instruits à l’école de l’Europe.
À l’indépendance, toutes les grandes familles de Fès avaient des fils dans les universités et les grandes écoles françaises. Les élites rurales étaient dans l’Armée ou à l’École militaire. Je simplifie, mais la réalité ici est presque aussi caricaturale. Il est naturel que le gouvernement indépendant ait puisé dans ce vivier des grandes familles fassies pour y trouver un personnel politique, administratif et technique pour gérer un appareil d’État très comparable à celui légué par le Protectorat, puisqu’il appliquait au fond les mêmes normes. Situation nouvelle à l’échelle de !’Histoire: autrefois le pouvoir central au Maroc prenait plutôt ses serviteurs dans l’armée. À voir ce qui se passe un peu partout en Afrique, rien ne garantit que le phénomène soit irréversible.
L’osmose entre la haute administration et les milieux d’affaires explique la prise d’un quasi-monopole de la direction du pays à Rabat et Casablanca par la bourgeoisie citadine. Bien entendu il y a des outsiders: je pense notamment à l’entreprise, au commerce intérieur de gros et de détail, aux ateliers de montage et de petite fabrication où des mutants du Sud-Ouest se sont taillé des fiefs.
L’avantage culturel des grandes familles et de leur système de relation est difficile à réduire pour les nouvelles générations qui sortent des facultés et des grandes écoles avec le handicap d’une extraction plus modeste. Prosaïquement, les places sont prises! La mobilité sociale est forte, mais … en dessous de ces grandes familles. Comme autrefois, c’est le passage au pouvoir – directions centrales, ministères … – qui permet aux personnes de petite origine d’accéder à la renommée, au capital et à la réussite sociale.
Q18 – Comment qualifieriez-vous la société marocaine aujourd’hui ?
R- La société marocaine est encore en 1979, vingt-ans après l’indépendance, une société dominée par les grandes puissances industrielles. Cette société n’est pas en transition, c’est-à-dire qu’elle ne s’est pas formé un projet de société cohérent assez crédible pour obtenir un consensus suffisant de l’ensemble de la nation. Elle ne cherche pas à liquider un ancien ordre des choses pour en construire un nouveau. La société marocaine vit sur son inertie, elle veut profondément se perpétuer dans son être, les yeux tournés vers un âge d’or traditionnel révolu, à quoi on espère ajouter de la technologie moderne. Elle veut ignorer que la colonisation a été, que l’impérialisme demeure, que l’industrialisation est, pour une longue durée au moins, un phénomène irréversible qui va entraîner de profonds changements à la périphérie de l’Europe.
Les dirigeants, même quand ils l’affirment, ne prennent pas suffisamment en compte les effets de la croissance démographique. Le Maroc d’aujourd’hui, est deux fois plus peuplé que le jour de l’indépendance, il y a vingt-trois ans. La moitié de la population a moins de dix-huit ans et les trois-cinquièmes n’ont pas connu le Protectorat.
Face à l’ampleur de cette situation nouvelle, les politiques proposées sont courtes, indigentes et médiocres. La centralisation rend important un État qui se déclare omnipotent. La décentralisation est encore un phénomène timide, imprécis, une simple hypothèse administrative.
Dominée, drainée par les grandes puissances, la société marocaine n’a pas en mains les moyens de sa transformation: un projet national et une accumulation interne qui permettent de mobiliser les énergies et payer le prix de la transition. D’où la nécessité pour les élites dirigeantes de bricoler, de faire du nouveau avec de l’ancien, en confiant aux structures traditionnelles emboîtées (tribales, caïdales, confrériques …) l’encadrement et la gestion au moindre coût du court terme sans cesse reconduit. C’est pour cela que j’ai parlé de société composite pour opposer cette espèce à la société de transition.
La question que l’on peut se poser cependant est de savoir s’il est possible en l’état actuel d’imaginer un modèle crédible de société qui recueille un consensus suffisant étant donné l’extraordinaire variété, étalement et émiettement des intérêts et des opinions. Vingt-trois ans de composition, de compromis et de bricolage des structures nationales, à quoi il faut ajouter quarante-quatre ans de Protectorat, et cinquante années d’affaiblissement économique, ne permettent peut-être plus d’ouvrir sur des solutions claires et acceptables pour un ensemble assez large de forces sociales.
Ne faut-il pas craindre que de grandes épreuves viennent à point nommé pour décanter et coaliser ces forces et dégager une ligne ? Auquel cas le plus urgent n’est peut-être pas le projet national – lequel risque fort de déboucher sur une nouvelle trouvaille dogmatique et totalitaire – mais le développement de forces sociales, de groupes, de mouvements plus autonomes, plus libres, plus démocratiques. La société marocaine devenant une somme de courants solidaires, contractuels ou en compétition, plutôt qu’un impensable modèle froid.
Retour au sommaire du livre